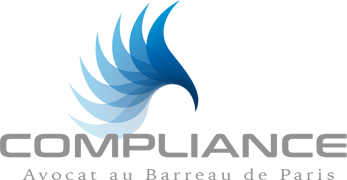Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCBFT) dans le secteur immobilier
A côté des secteurs bancaires et assurantiels, le secteur immobilier doit se sentir également très concerné en matière de lutte contre le blanchiment et de financement du terrorisme (LCBFT). Pour le GAFI, le secteur immobilier figure parmi les branches les plus exposées aux tentatives des criminels d’intégrer des capitaux à blanchir dans le circuit économique légal. TRACFIN estime de son côté que le secteur figure parmi les « mauvais élève » au regard du nombre de déclarations de sanction[1].
Créée en 2009, la Commission Nationale des Sanctions[2] est l’autorité indépendante chargée de sanctionner les manquements aux obligations issues du dispositif de LCB/FT commis par les professionnels soumis à ce dispositif[3].
Venant de rendre public son rapport annuel pour l’année 2018, on apprend que sur les 128 sanctions prononcées par la Commission nationale des sanctions en 2018, 89[4] concernent des agences immobilières.
Parmi les manquements généralement constatés qui conduisent à la sanction, on constate malheureusement les mêmes reproches qu’au cours des années antérieures :
- absence de formation et d’information des collaborateurs sur la LCBFT,
- absence de mise en place des systèmes d’évaluation et de gestion des risques,
- manquements portant sur l’obligation d’identification et de vérification de l’identité du client et des bénéficiaires effectifs.
Le non-respect des obligation précitées à entrainer le prononcé de plusieurs types de sanctions, parfois cumulatives, incluant 33 d’interdictions temporaire d’exercice de l’activité avec sursis, 4 avertissements, 2 blâmes et 33 sanctions pécuniaires[5].
En dépit de la multiplication des sanctions et de la publicité qui leur est donnée, le président de la CNS estime que la connaissance par les professionnels de l’immobilier de leurs obligations demeure insuffisante ou n’est pas encore assez précise.
Si jusqu’à présent la publication anonymisée des décisions de sanction est quasi systématique dans un but d’information des professionnels du secteur, le principe sera désormais inversé, à l’instar de ce que font l’ACPR ou l’AMF, la publication sera nominative sauf exception décidée par la CNS sollicité par le défendeur (ordonnance du 1er décembre 2016 et le décret d’application du 18 avril 2018)
Il est donc urgent pour tous les acteurs du secteur immobilier d’entamer une démarche de mise en conformité consistant notamment :
– à se doter d’un système de gestion et d’évaluation des risques en veillant à l’adapter aux caractéristiques de leur activité et de leur clientèle, et le partager à l’ensemble de leurs collaborateurs et/ou apporteurs d’affaires éventuels ;
– à mettre en place des procédures d’identification des clients, tant personnes physiques que les personnes morales, françaises ou étrangères, personnes politiquement exposées (PPE) ou non,
– à recueillir un maximum d’informations sur le client lui-même et sur l’opération immobilière envisagée,
– à sensibiliser et former l’ensemble des collaborateurs sur cette thématique.
Le fait que les clients soient présentés par des tiers (notaire ou avocat) n’exonère pas l’agent immobilier, en sa qualité de professionnel assujeti, de ses obligations. De même, l’intervention d’un notaire pour la rédaction des actes juridiques et/ou le financement par un établissement bancaire n’est pas plus de nature à exonérer le professionnel de ses obligations en matière de LCBFT.
Bref, la démarche est donc propre à chaque cabinet qui peut, si nécessaire, se faire accompagner pour trouver des solutions pragmatiques de mise en œuvre de cette législation au regard de sa propre organisation, de sa typologie de clientèle, ….
Me Alain CURTET
Avocat au Barreau de PARIS
[1] – Sur un peu plus de 76.000 déclarations de soupçons (DS) reçues par Tracfin, seules 274 (soit environ 0,4% du total des DS) émanaient de professionnels de l’immobilier, un chiffre toutefois en progression de 54 % par rapport au nombre de DS de l’année précédente
[2] – régie par les dispositions L. 561-38 et suivantes et R. 561-43 et suivants du Code Monétaire et Financier
[3] – Parmi lesquels on trouve notamment les agents immobiliers, les sociétés de domiciliation, les professionnels du secteur des jeux et paris traditionnels (FDJ, PMU, casinos, ….) ou en ligne, les antiquaires, les agents sportifs ou encore les personnes se livrant au commerce de certains biens (pierres précieuses, métaux précieux, bijoux ….).
[4] – soit 70 % de l’ensemble des décisions de sanction
[5] – Si les sanctions pécuniaires peuvent aller jusqu’ à 5 Millions d’euros, en 2018, 9 sanctions pécuniaires sur 48 ont atteint un montant supérieur ou égal à 5 000 euros, dont 3 sanctions de 10 000 euros ou plus